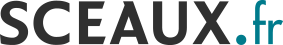Un nouvel entrant au jardin des Félibres
Louis Guillaume FULCONIS « Lou felibre dóu Cisèu »
On peut parler à propos du sculpteur et statuaire Louis Guillaume Fulconis de l’intérêt culturel, cultuel et historique de ses travaux, tous aspects associés tout au long de son œuvre.
Il a été le premier sculpteur de la présence française en Algérie et, par le fait et par goût, le premier sculpteur orientaliste dans ce pays, et tout au long de sa vie, avec un souci d’exactitude ethnographique reconnu. Il a été pionnier en France du néogothique, le gothique retrouvé : des centaines de ses œuvres, en plusieurs lieux, ont été reconnues monuments historiques.
Il a été « le félibre du ciseau », le sculpteur des 50 premiers félibres coopté par les Primadié dès le statut originel de 1862, essentiellement par Frédéric Mistral et Joseph Roumanille, et il a donné à la Provence, par les Catalans, et à toutes celles et tous ceux qui s’y rallient, son plus beau et clair symbole, « la Coupe de la Fraternité », « la Coupe de l’Hospitalité ».
Une plaque commémorative rappelle son baptême le 16 février 1818 à la Basilique Saint-Pierre d’Avignon. Cette plaque, par une bienvenue coïncidence, est placée sous la plaque dédiée à Nicolas Saboly, le prêtre, poète, compositeur, qui repose dans cette église où il termina sa mission de maître de chapelle. Il se trouve d’ailleurs que le sculpteur avait préparé un monument à Nicolas Saboly que la mort l’empêcha de signer.
Dans sa courte carrière professionnelle de quelque trente-sept années, puisque mort à l’âge de 55 ans, le sculpteur statuaire que fut Louis Guillaume Fulconis, a fourni des travaux considérables en Algérie, en Normandie, à Paris, et pour ce qui concerne la Provence, son symbole le plus significatif, sa Coupe.
Il se trouve que les amitiés dont il bénéficia, grâce à son sens de la fraternité et du service, furent souvent religieuses, encore que l’amitié avec les premiers députés républicains d’Alger en 1848 lui valurent d’être en 1851, lors de son retour en France le 10 août, le seul sculpteur à avoir eu son atelier dans les locaux mêmes de l’Assemblée Nationale ; ce à quoi le coup d'État du 2 décembre 1851 met fin, lui laissant cependant le temps de faire le buste de plusieurs députés, certains d’entre eux peut-être commencés à Alger.
Louis Guillaume Fulconis bénéficia aussi de l’appui de toutes les autorités auxquelles il eut affaire :
- Le premier responsable de la nouvelle église algérienne, l’abbé Joseph Marie Montera ;
- le premier responsable civil d’Algérie « gouverneur général » avant la lettre, le comte Eugène Guyot qui l’estima au point de mettre à Paris sa photo dans son album familial ;
- le général Clauzel, le vénérable Descous, officier d’Empire et conseiller municipal d’Alger, le juge Giacobbi d’Alger, Adrien Berbrugger, le Duc d’Aumale, Louis-Napoléon président de la République, les députés républicains d’Alger, les deux évêques de son séjour algérien, Mgr Dupuch et Mgr Pavy. De tous, il fit le buste.
À Paris

Nieuwerkerke intendant des Beaux-Arts de la Maison de l’Empereur (contacté à propos du buste et de la statuette du Petit prince impérial, 1859) qui le présente à la princesse Mathilde, l’éclairée cousine de Napoléon III, dont il sera l’ami et dont il fait le buste en marbre en 1860 (Musée d’Orsay).
En Normandie :
L’archevêque Blancart de Bailleul commanditaire de ses travaux dans sa cathédrale de Rouen ;
- Le cardinal-prince de Croÿ qui bénira la première pierre de Notre-Dame de Bonsecours et dont le sculpteur fera le gisant pour la cathédrale de Rouen ;
- D’éminents jésuites, comme le Père Mas ou le Père Arthur Martin, archéologue éminent, sont à l’origine de la commande des travaux à l’église Saint Ignace de Paris et à l’église des Jésuites de Toulouse (une vingtaine de statues et bas-reliefs retraçant l’histoire de la Compagnie).
En Provence
- Joseph Roumanille, « le père du Félibrige » et Frédéric Mistral, son génie, l’ont entouré, de leur amitié et de leur reconnaissance pour son oeuvre de la Coupe à la vue de laquelle ils avaient compris que toutes les générations se retrouveraient en toute fraternité, à l’unisson du chant qu’elle inspira à Mistral.
- Comme le poète, journaliste et homme politique Catalan Victor Balaguer, (or)donateur avec 1800 notables Catalans de la Coupo Santo aux Provençaux,
- Ou comme le poète William Bonaparte-Wyse,…
Louis Guillaume Fulconis est aussi, le premier, à avoir donné chair à la Princesse Clémence de Frédéric Mistral, que lui inspire la lecture du chant XI de Calendau, aussitôt paru.
Mais on ne peut que revenir à cette constante du personnage, l’amitié, l’amitié pour des gens de qualité quel que soit leur bord, amitié d’ailleurs qui lui est bien rendue.
Aussi de nombreuses églises (comme d’ailleurs des mosquées) ont accueilli ses œuvres, en Algérie d’abord, où ses quatre grands chantiers connus à ce jour, la Djemâa el Kébir, la Dar Hassan Pacha faisant face à la Dar Aziza, et la Ketchaoua jouxtant celle-ci, ont tous les quatre été classés monuments historiques par l’état algérien en continuité avec les classements de l’administration française. Si pour trois d’entre eux, il n’est intervenu qu’en restaurations et ajouts, pour la Ketchaoua, entièrement reconstruite, il en est, pour sa partie, la décoration, le créateur principal. L’Unesco l’a d’ailleurs classée au patrimoine mondial de l’Humanité, en même temps que la Casbah.
À Paris, il avait commencé par diverses décorations de la rénovation du Louvre ; une de ses statues, originellement destinée au Louvre, l’Actéon et son chien (1860) est, à la demande de l’Impératrice, installée dans le parc de Fontainebleau. À l’église Saint-Laurent, deux de ses statues ornent, entre autres, la façade inscrite à l’inventaire des monuments historiques.
En 1855 il garnit de 15 statues le ciborium en gothique flamboyant du tombeau de Sainte-Geneviève à Saint-Etienne-du-Mont et, en 1859, y fait avec 3 statues le monument reliquaire du cœur de Mgr Sibour assassiné dans cette église, qu’il avait connu en Algérie lors de la translation des reliques de Saint-Augustin dont il avait fait la statue du tombeau (reliquaire) à Hippone (aujourd’hui Annaba).
On peut noter que grâce à la constante considération et à l’amitié fidèle de l’architecte normand Jacques-Eugène Barthélémy, Louis Guillaume Fulconis, qui n’a cessé, depuis sa jeunesse d’orphelin de père et de mère à l’âge de 12 ans (sans aucun héritage autre que le goût de la pierre et du travail bien fait que son père lui a inculqué, l’amitié de son collègue de travail qui l’héberge, et des prêtres d’Avignon) de se cultiver d’abord à l’école des Beaux-Arts d’Avignon puis de Marseille, tout en travaillant pour gagner sa vie, notamment avec les Cantini, se trouve avoir été le premier, en date et en fidélité, sculpteur statuaire du gothique retrouvé en France dès début 1852, comme il avait été le premier sculpteur et statuaire français en Algérie à son arrivée en 1835.

Geneviève, Eglise St Etienne du Mont,
Paris (1855-1856), Les Vierges Sages
(détail)
Il tire parti de son séjour algérien pour être un des statuaires (aucun avant lui, et par la suite très peu nombreux) à produire avec précision des types algériens, ce qui permet de le caractériser, pour la pierre, comme un des précurseurs de l’Orientalisme et, surtout, par sa fidélité aux sujets originaux, comme artiste soucieux de vraie ethnologie sans interprétation infidèle.
Le désintéressement de Louis Guillaume et le scrupuleux respect de ses engagements, font qu’il revient d’Algérie aussi pauvre qu’il y est arrivé, à la suite de la faillite de la fabrique de la Cathédrale, et qu’à sa mort il ne laisse à son fils, formé aussi sculpteur statuaire, qu’un héritage d’œuvres à terminer… Avec la consigne écrite absolue de payer ses employés rapidement et scrupuleusement.
Louis Guillaume Fulconis a cependant laissé partout où il est passé le témoignage de son amitié pour les hommes et les femmes qu’il a côtoyés. À travers les pierres qui portent la marque de ses mains et les signes qu’il a tracés, il les a réunis dans l’amour auquel le portait sa foi et son caractère. Algériens, Normands, Parisiens, Provençaux ou Toulousains en ont des preuves.
Sa courte vie et sa modestie constante, n’ont pas empêché la considération, et plus ! l’amitié, de ceux qu’il a côtoyés, de tous pays et de tous milieux.
Ses œuvres restent : l’État français et l’État algérien en ont classé comme monuments historiques, particulièrement ses œuvres religieuses ; le château de Versailles a acquis son buste du comte Eugène Guyot ; son buste de la princesse Mathilde est exposé au Musée d’Orsay ; son buste du vénérable Descous a rejoint les collections du Musée du Grand Orient de France ; ses bustes de Camille et de François Vincent Raspail (le grand Raspail, vauclusien de Carpentras, médecin et homme politique français) et celui d’Abraham Lincoln sont au Musée Carnavalet, sa Bayadère au Musée de Gray, son Petit Prince au musée national de la Légion d’honneur, etc.
Il a enfin formé des disciples, et transmis : à son fils Victor d’abord et notamment, sculpteur comme lui (qui poursuit et achève les travaux en cours à la mort de son père), enseignant et promoteur de l’enseignement artistique dans l’enseignement public de la IIIᵉ République de la fin du XIXe siècle.
Victor réalisera, quelque 35 ans après son père, sa Princesse Clémence pour le Salon des artistes de 1902, l’offrira à la municipalité d’Avignon, et ira en 1904 porter en Arles à Mistral, à l’instigation de ce dernier qui lui a tout simplement soufflé l’idée d’enrichir ses collections de l’une et/ou de l’autre Princesse Clémence, pour son Museon Arlaten (le premier musée d’art et tradition populaires de France, que Mistral fonde grâce à l’argent (notamment, mais pas seulement puisque c’est l’œuvre d’une vie) de son prix Nobel de littérature), deux réductions en terre cuite de 35 cm des Princesses Clémence de Louis Guillaume et de Victor. Mistral les installe en présence de Victor et de l’ainé de ses fils dans la chambre de l’accouchée où de fait, elles se trouvent toujours, posées sur la commode, 120 ans plus tard.
Sculpteur de la Coupo Santo
L’année 1867, année de création et première sortie de la Coupo Santo
On sait qu’en 1867, il y a cent cinquante-sept ans, 1800 notables catalans se sont cotisés pour faire un don de reconnaissance aux félibres provençaux qui avaient accueilli à Avignon Victor Balaguer, leur représentant littéraire et politique, exilé d’Espagne. Ainsi ce « groupe admirablement créé, et réussi, par le statuaire Fulconis, d’Avignon », écrit Mistral dans l’Armana provençal, « fait double honneur à l’artiste. » Il insiste sur le fait que l’artiste, dit-il « apprenant la destination patriotique de l’objet, a refusé tout paiement et généreusement donné son art divin à l’idée poétique et nationale ».
À l’instant où Louis Guillaume Fulconis crée l’objet qui doit personnifier la fraternité par de là les Catalans et les Provençaux s’enclenche tout le symbolisme de la Coupe et naît chez Mistral l’inspiration du chant qui va la parrainer, et l’accompagner tout au long de sa vie.
Il faut avoir mis dans ce geste, qui de tout temps a été un signe d’affection, du bras sur l’épaule de l’autre et dans ces regards entrecroisés toute la dilection de l’amitié pour que ce petit objet symbolise à tout jamais la fraternité. Tout le symbolisme que Fulconis a mis dans la Coupe a été progressivement mis à jour par les félibres eux-mêmes et plus particulièrement par les Capoulié, les « grands-maîtres du Félibrige » qui en sont à la suite de Frédéric Mistral les gardiens.
C’est aussi l’année où Louis Guillaume Fulconis crée sa Princesse Clémence
Dont l’inspiration lui vient à la lecture de Calendau de Frédéric Mistral, qui vient de paraître et qui lui a été aussitôt adressé.
Mistral, lors de son séjour à Paris à l’hiver 1867, n’en voit pas encore la première ébauche dans l’atelier de Louis Guillaume, avenue de Ségur. C’est six mois plus tard que Louis Guillaume commence de l’y modeler (octobre 1867). Depuis la naissance du projet jusqu’à sa présentation au Salon de 1868, Mistral et Fulconis échangent une importante correspondance à son sujet (le projet, l’attitude à lui donner, puis sur l’œuvre achevée et sa photographie). Mais également, Roumanille, Bonaparte Wyse, Balaguer. Victor Balaguer, lui, la voit prendre chair dans l’atelier de Louis Guillaume en mars 1868 lorsqu’il lui rend visite.
C’est enfin l’année de l’Exposition Universelle, la dernière du Second Empire
où Guillaume présente de nombreuses œuvres, toutes inspirées de son séjour algérien, saluées par le public et les chroniques de l’événement, dont certaines représentées ici.